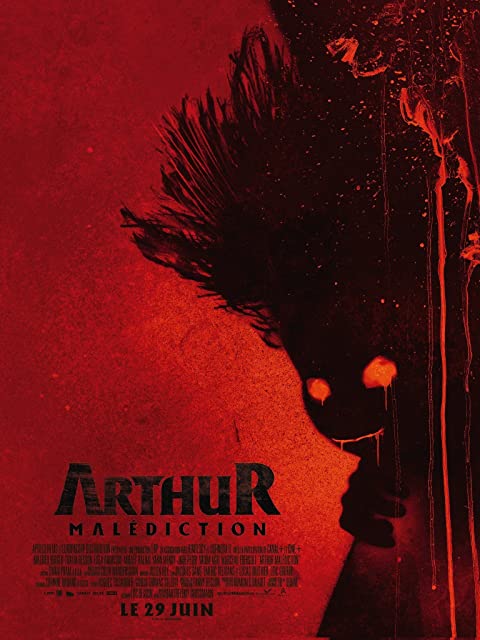La abuela/Abuela (Paco Plaza, 2021)

Ecrit le
28
mars
2022
par
Boris Moon

Score qualité : ★★★★☆
Score personnel : ♥♥♥♥♡
En 2007, Paco Plaza s’est fait une réputation en or avec [Rec], surfant à la fois sur la vague des films de zombis et notant la popularité croissante des found-footage. Lui et le co-réalisateur Jaume Balagueró ont réussi à se démarquer de leurs contemporains en suivant l’exemple de The Blair Witch Project, et son approche improvisée à l’écriture et la direction. Contrairement à Diary of the Dead sorti la même année, les zombis étaient d’avantage inspirés par 28 Days Later, et moins leurs origines mystiques.
Synopsis et vue d’ensemble :
Cette vision moderne et nerveuse du film de zombis, le prive parfois du sous-texte cinglant de l’œuvre de George A. Romero, et minimise les éléments horrifiques du genre, conduisant aux films d’actions que sont les Resident Evil et World War Z. Paco Plaza a sûrement remarqué cette limitation et a complètement changé de ton dans [REC]³: Génesis avant de laisser Jaume Balagueró se charger du film suivant.
Pour son premier pas dans les des années 2020, Paco Plaza a décidé de prendre une direction presque classiciste et d’offrir une expérience horrifique mémorable et abordable. La abuela n’est pas aussi tout public que A Quiet Place, mais n’est pas destiné uniquement aux fans du genre à la recherche des cauchemars concoctés par Ari Aster, ou de l’humour post-ironique de Malignant. Ses principales qualités sont la clarté de sa présentation et son traitement empathique des personnages.
L’histoire est majoritairement présentée du point de vue de la protagoniste, Susana, une jeune mannequine qui commence le film à Paris à la recherche de sa prochaine séance photo. Peut-être inintentionnellement, La abuela se présente d’abord comme un pastiche du Neon Demon de Nicolas Winding Refn, avec ses couleurs primaires, ses mannequins ambitieux et artistes prétentieux. Cependant, avant que Susana ne quitte définitivement le monde réel pour celui de Refn en se faisant une ligne de cocaïne sur son téléphone, ce dernier sonne avec des nouvelles qui la poussent à retourner à Madrid.
Après cette introduction, la cinématographie adopte un style trompeusement plus sobre. Tout comme la simplicité, voire austérité, de la vie que Susana a laissée derrière elle pour poursuivre sa carrière, elle cache bien des surprises. D’un point de vue purement technique, La abuela a été filmé avec le même type de pellicule utilisé pour la dernière trilogie Star Wars. Cette dernière a aussi évité le « tout numérique » afin de reproduire l’esthétique du siècle dernier, mais a tout de même profité des avantages offerts par 50 ans d’innovation. L’image est contrastée, le grain à peine visible et, malgré sa banalité, toutes les subtiles couleurs de l’environnement sont mises en valeur.
Ce choix technique offre aussi des opportunités artistiques : certains flashback, par contraste, ont l’apparence de la vidéo numérique produite par les caméras grand public des années 2000. Pendant ces séquences, l’image garde le même ratio d’aspect 16:9 et le changement de qualité est suffisamment subtile pour qu’il ne soit perceptible que subconsciemment. C’est le style presque found-footage des flashback qui tranche avec le reste de la présentation, qui est tout en modération.
Certains choix de mise en scène semblent avoir été faits pour des raisons purement esthétiques et pour donner une identité au film, mais les événements sont présentés de manière naturelle. L’image de synthèse n’est quasiment pas utilisée, et les mouvements de caméra sont très lisibles. Néanmoins, certains de ces mouvements visent clairement à nous faire perdre nos repères malgré leur simplicité.
Plusieurs plans commencent avec un point de vue qui semble être celui du personnage explorant une pièce, mais ce dernier finit par apparaître à l’écran à un endroit inattendu. D’autres sont complètement flous avant qu’un personnage n’entre dans le champ et donne un point central à la composition. Similairement à May, La abuela a occasionnellement recours à des visuels plus abstraits pour fluidifier son récit. Le plus apparent est la sortie de scène de Susana lorsqu’elle quitte Paris et s’engouffre dans une ruelle sombre : la version subtile d’une transition qui aurait pu être dans Last Night in Soho.
Comme ce dernier, La abuela est également féru de miroirs, mais leur utilisation est ici moins théâtrale. La majorité de la charge émotionnelle est portée par Almudena Amor qui joue Susana, dans son second rôle au cinéma. La combinaison du script et de son interprétation conduit à un personnage attachant, mais surtout avec lequel on peut s’identifier. Malgré son contenu horrifique, le récit de la protagoniste est raconté avec le naturel de la mauvaise journée qu’aurait passée un ami. Paco Plaza et le scénariste Carlos Vermut arrivent à trouver des instants d’humour dans sa misère qui, plutôt que la moquer, nous rappellent son humanité.
Cet humour a l’avantage de rendre les virages que prend le scénario plus simples à appréhender. Malgré la prévisibilité de certains d’entre eux, ils n’en restaient pas moins difficiles à exécuter sans tourner au ridicule. Les auteurs ont fait l’effort de préparer le terrain pour que le film reste satisfaisant narrativement et garde un ton cohérent. Malheureusement la précision de la réalisation et l’humour noir conduisent parfois à certain un détachement émotionnel, mais la performance de Almudena Amor permet toujours de se réinvestir dans l’histoire.
Spoilers :
[expand]
Un avantage de l’écriture de Susana, est que sa situation n’est pas une forme de vengeance sur les méfaits qu’elle aurait commis. Elle doit revenir en Espagne pour s’occuper de sa titulaire grand-mère qui a fait un AVC, après l’avoir supposément délaissée pour poursuivre sa carrière. Cependant Pilar, la grand-mère, est présentée dès le début comme étant autonome et surtout très inquiétante. Susana n’hésite pas à quitter Paris et à prendre soin de Pilar aussi longtemps qu’elle le peut, tout en évitant les solutions de facilité, comme une maison de retraite. Une histoire plus générique aurait présenté un personnage moins attentionné et forcé dans cette situation malgré sa volonté d’en finir au plus vite. La sinistre fin du film aurait été une satisfaisante rétribution pour ses actions, au lieu de prendre le ton tragique et terrifiant qu’elle a ici.
Certains seront peut-être déçus par cette fin, et par la simplicité du scénario en général, mais c’est la petite échelle du film qui rend les petits détails mémorables. Les deux premiers actes sont si ancrés dans la réalité que toute divergence, aussi subtile soit-elle, provoque une réaction. L’histoire d’une jeune personne s’occupant avec soin de sa grand-mère qui ne dispose plus de ses capacités mentales fonctionnerait aussi bien dans un drame, où certains tabous ne seraient pas brisés. L’horreur n’a pas cette contrainte et le film fait de chaque jour de la vie de Susana une épreuve presque insurmontable. On peut y trouver une certaine ressemblance avec la situation de Henry Spencer dans Eraserhead.
Les divers sacrifices que fait Susana pour sa grand-mère sont rappelés régulièrement, mais pas au point de diaboliser Pilar, puisqu’on adopte le point de vue naïf de la protagoniste. Elle cherche à joindre son agent avec de plus en plus de difficulté et se voit vieillir alors que d’autres mannequins prennent sa place. Pourtant elle ne décide de mettre fin à cette situation qu’après avoir été convaincue des mauvaises intentions de Pilar suite à une escalade d’événements macabres. C’est dans le troisième acte que des références visuelles et scénaristiques à d’autres films des années 1970 deviennent plus apparentes, notamment The Sentinel et The Mephisto Waltz.
D’autres références sont plus superficielles, allant du terme « Magical Girl » qui était un élément d’un autre film de Carlos Vermut, jusqu’à la mention du nom de « Romero ». Cette dernière est coutume depuis 50 ans mais n’est pas devenue moins maladroite avec l’age. Les autres maladresses du script sont généralement excusables : deux rêves qui ne font pas beaucoup avancer l’histoire mais sont esthétiquement réussis et illustrent l’état mental de la protagoniste, et certains détails « horrifiques » sans trop de justification.
[/expand]
Conclusion :
L’ambiance de La abuela est parfaitement entretenue par les événements tangibles et l’attention à l’aspect sonore sans avoir à artificiellement choquer le spectateur. Il n’y a aucun jumpscare auditif, et Paco Plaza utilise la mise en scène et surtout le placement des acteurs pour nous surprendre. La musique est très variée, allant de guitares sèches aux synthétiseurs évocateurs de la musique de Goblin. Tout comme The Empty Man, le film sait très bien utiliser les chuchotement pour faire frissonner le spectateur, mais j’espère que cette idée ne sera pas surexploitée par la suite.
Si l’œuvre de Paco Plaza est preuve d’une chose, c’est que les grand-mères au cinéma sont une source riche d’horreur. Il est difficile de dire si ce film résonnera avec le public général comme [Rec] l’a fait 15 ans auparavant. La abuela n’est pas aussi innovant mais semble par ailleurs plus intemporel. La séance à laquelle j’ai assistée était une avant-première à dix heures du soir, mais la salle était décemment remplie. C’est un signe encourageant pour le succès d’un film professionnel qui sait être accessible sans faire de compromis sur le contenu.